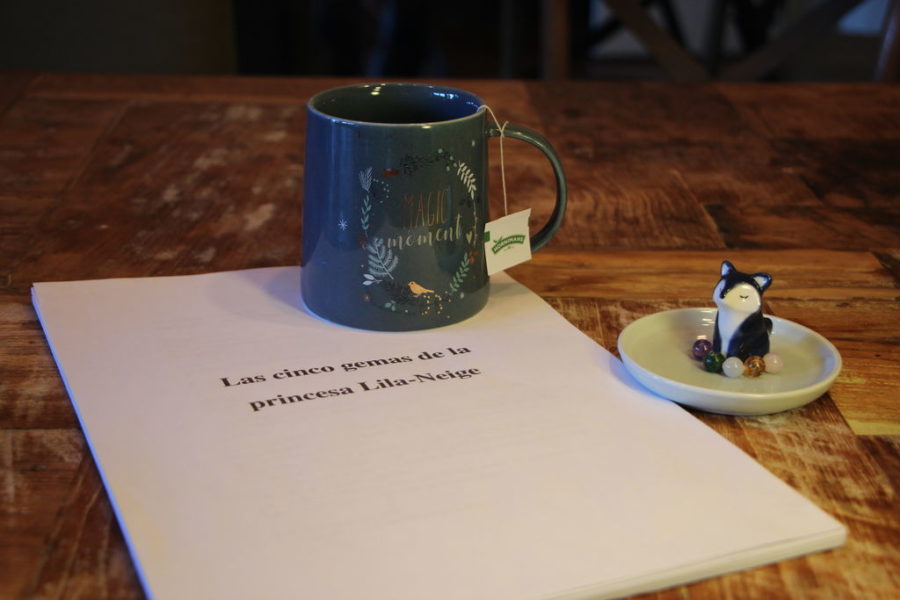Toute cette semaine, j’ai préparé l’envoi de mon conte « Les cinq joyaux de la princesse Lila-Neige » à des agents espagnols.
Pour ce faire, il a d’abord fallu que je le fasse traduire et heureusement, j’ai trouvé une traductrice qui partage mes goûts et mes sensibilités (merci Carlota !) parce que la décision de quitter la langue française que j’adore m’a coûté.
Mais j’ai choisi de chercher un éditeur en dehors de la France.
Pourquoi ?
Déjà, je suis expatriée et les maisons d’édition travaillent pour la plupart à l’ancienne, en demandant l’envoi d’un manuscrit ENTIER et sur format PAPIER, ce qui, compte tenu de leurs exigences en termes de marges (larges) et d’espacement (conséquent) commençait à faire cher en impressions et en frais de port…
Et m’amusait un peu quand je visualisais mon manuscrit à l’arrivée, gardé pendant les trois mois réglementaires, poussé par un employé vieux et voûté dans une cave que j’imaginais obscure, sur un charriot à roulettes, uiiiiiiiiiiiiiiiik, uiiiiiiiiiiiiiiiiik, uiiiiiiiiiiiiiiik, avant de rejoindre les 300 manuscrits envoyés par jours à ces vénérables institutions, sur une étagère que je voyais, en dépit du trafic en bouquins, poussiéreuse et couverte de toiles d’araignées.
On gère sa frustration comme on peut et je demande pardon au passage aux employés de ces nobles maisons d’édition, sans doute des stagiaires rémunérés à leur seule passion qui rangent les manuscrits dans une salle blanche et pourvue de néons qui doit exhaler la chaleur d’une salle d’opération.
Oups, je l’ai refait.
Encore pardon !
Mais les maisons d’édition françaises vivent le paradoxe (et notez au passage que je n’ai pas dit l’hypocrisie) de vouloir se revendiquer comme institutions d’art, refusant de passer à travers les mains mercantiles d’un agent, réclamant le contact direct avec l’auteur, la main dans la glaise et tout ça, tout en étant, et c’est logique, soumis à une logique de vente.
Parce que oui, il faut bien vivre.
Et donc, le monde étant ce qu’il est, il faut, là aussi, établir une stratégie commerciale, trouver des niches, polir sa communication et… définir une ou plusieurs « lignes éditoriales ».
Ah, la fameuse « ligne éditoriale » ! Elle est, en fait, à l’opposée du mode de pensée de l’artiste, qui a lui, le naïf, tendance à vouloir exprimer sa personnalité et donc à faire différent.
Elle implique que chacun doit pouvoir rentrer dans un des rangs prédéfinis par le marketing et que, s’il faut absolument être original, il faut savoir l’être au sein d’un cadre.
Ce que, encore une fois, je comprends.
Je le comprends d’autant mieux que je serais, sinon, assez vite reléguée dans la foule des « génies » incompris et autres pleurards médiocres, incapables de s’adapter à la réalité de notre société compétitive et moderne. Fi, donc, sachons avoir l’intelligence d’affronter la réalité.
Et comme, pour revenir au propos qui m’occupe, le monde de l’édition française veut s’accrocher, malgré tout, à l’idée d’être en premier un milieu d’art, et qu’il a banni les agents de son écosystème, tout le travail de trouver un éditeur qui correspond un temps soit peu au livre que tu as écrit, ce travail-là te revient.
Et haro sur le baudet et sur l’auteur, si par malheur, en allant sur les sites Internet, ou en scrutant le marc de café et les couvertures de livres déjà publiés, tu t’es gourée dans les intérêts et les envies de l’éditeur concerné. Haro, tudieu ! Tu viens de démontrer ton manque de respect.
Bref, je craque un peu, vous l’aurez constaté.
Et comme les agents littéraires ne sont pas reconnus dans mon pays, mais qu’ils le sont dans d’autres, adieu Berthe et douce France, je vais tenter ma chance à l’étranger.